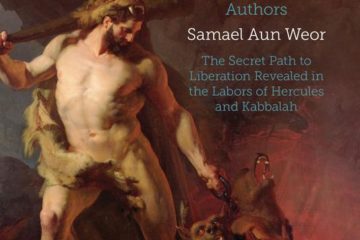Écrit par : Samael Aun Weor Catégorie : Les Trois Montagnes
Il n’est pas inutile d’affirmer solennellement que je naquis avec d’énormes inquiétudes spirituelles ; le nier serait absurde.
Bien que pour beaucoup, le fait qu’il existe au monde des gens qui puissent se souvenir dans le détail de la totalité de leur existence, y compris de l’évènement de leur propre naissance, paraisse quelque chose d’insolite et d’incroyable, je tiens à affirmer que je fus l’un de ceux-là.
Après le processus classique de la naissance, très propre et joliment habillé, je fus placé délicieusement dans le lit maternel, près de ma mère.
Un géant très gentil, en s’approchant du lit sacré, me contemplait en souriant doucement. C’était mon père.
Inutile de dire, clairement et sans ambages, qu’à l’aube de l’existence nous marchons d’abord à quatre pattes, ensuite avec deux et finalement, avec trois. Cette troisième est évidemment la canne des vieillards.
Mon cas, d’une certaine façon, pouvait être une exception à la règle générale. Quand j’atteignis onze mois, je voulus marcher et il est évident que j’y parvins en me maintenant fermement sur mes deux pieds.
Je me souviens encore parfaitement de cet instant merveilleux où, en entrelaçant mes mains sur ma tête, je fis solennellement le signe maçonnique de détresse : Elaï B’ Neal’ Manah.
Et comme il se trouve que je n’ai pas encore perdu la capacité d’étonnement, je dois dire que ce qui arriva ensuite me sembla merveilleux. Marcher pour la première fois avec le corps que nous a donné la Mère Nature, est sans aucun doute un prodige extraordinaire.
Je me dirigeais très sereinement vers la vieille baie vitrée d’où on pouvait voir distinctement l’ensemble bizarre de personnes qui, ici, là ou là bas, apparaissaient ou disparaissaient dans la petite rue pittoresque de mon village.
Ma première aventure fut de m’agripper aux barreaux d’une si vétuste fenêtre ; heureusement, mon père, homme très prudent, conjurant avec beaucoup d’avance tout danger, avait installé un grillage sur la balustrade afin que je ne puisse pas tomber dans la rue.
Vieille fenêtre d’un étage élevé ! Comme je m’en souviens ! Vieille bâtisse centenaire où j’ai fait mes premiers pas.
J’aimais bien sûr à cet âge délicieux les jeux enchanteurs avec lesquels les enfants se divertissent, mais ceci n’interférait en rien avec mes pratiques de méditation.
Pendant les premières années de la vie où on apprend à marcher, j’avais l’habitude de m’assoir à la manière orientale pour méditer.
J’étudiais alors rétrospectivement mes incarnations passées et il est évident que beaucoup de personnes de l’ancien temps me rendaient visite.
Quand l’extase ineffable se terminait et que je retournais à l’état normal, commun et ordinaire, je contemplais avec douleur les murs vétustes de cette maison paternelle centenaire où je paraissais, malgré mon âge, un étrange cénobite.
Comme je me sentais petit, face à ces grossières murailles ! Je pleurais, oui ! comme pleurent les enfants.
Je me lamentais en disant : encore une fois, dans un nouveau corps physique ! comme la vie est douloureuse ! Aïe ! aïe ! aïe !
Dans ces moments précis, ma bonne mère accourait toujours avec l’intention de m’aider et s’exclamait : « Le petit a faim, a soif, etc. ».
Je n’ai jamais pu oublier ces instants où elle courait dans les couloirs familiaux de ma maison.
À cette époque, des cas insolites de métaphysique transcendante m’arrivaient : mon père m’appelait du seuil de sa chambre, je le voyais en vêtements de nuit et quand j’essayais de m’approcher de lui, alors, il disparaissait en se perdant dans la dimension inconnue.
Je confesse néanmoins que ce type de phénomène psychique m’était très familier. J’entrais simplement dans sa chambre pour vérifier directement que son corps physique gisait endormi dans le lit d’acajou parfumé et je me disais à moi-même : ce qui arrive, c’est que l’âme de mon père est au-dehors, car son corps charnel est en train de dormir en ce moment.
À cette époque débutait le cinéma muet, et beaucoup de gens se réunissaient sur la place publique, pendant la nuit, pour se distraire, en regardant les films projetés en plein air sur un écran rudimentaire : un drap bien tendu cloué sur deux bâtons dûment écartés.
J’avais chez moi un cinéma très différent : je m’enfermais dans une chambre obscure et je fixais mon regard sur le mur ou la muraille. Après quelques instants de concentration intense et spontanée, le mur s’illuminait, resplendissant de lumière, comme si c’était un écran multidimensionnel, et les murailles disparaissaient définitivement ; ensuite surgissaient de l’espace infini des paysages vivants de la grande nature, des gnomes espiègles, des sylphes aériens, des salamandres de feu, des ondins sortis de l’eau, des néréides de l’immensité marine, de délicieuses créatures qui jouaient avec moi, des êtres infiniment heureux.
Mon cinéma n’était pas muet et il n’avait pas besoin de Rudolph Valentino ou de la fameuse Petite Chatte blanche des temps passés.
Mon cinéma était également sonore et toutes les créatures qui apparaissaient sur mon écran particulier chantaient et parlaient dans le levant très pur de la langue divine primitive qui court comme un fleuve d’or sous l’épaisse forêt du soleil.
Plus tard, lorsque la famille s’est multipliée, j’invitais mes innocents petits frères et ils partageaient avec moi cette joie incomparable en regardant sereinement les figures astrales sur l’extraordinaire muraille de ma chambre obscure.
Je fus toujours un adorateur du Soleil et aussi bien à l’aube qu’au crépuscule, je montais sur le toit de ma demeure (car à ce moment-là, il n’y avait pas de terrasse) et, assis à l’orientale comme un yogi infantile sur les tuiles de terre cuite, je contemplais l’Astre Roi dans un état d’extase, m’élevant ainsi en une profonde méditation ; je causais de grandes frayeurs à ma noble mère lorsqu’elle me voyait marcher sur la demeure.
Chaque fois que mon vieux père ouvrait la vieille porte de la garde-robe, il sentait comme si j’allais remettre cette curieuse jaquette ou casaque pourpre sur laquelle brillaient des boutons dorés.
Ancien vestige des vêtements de chevalerie que je portais avec élégance dans celle de mes anciennes réincarnations où je m’appelais Siméon Bleler, il arrivait parfois que dans cette vieille armoire soient gardés des épées et des fleurets de l’ancien temps.
Je ne sais pas si mon père me comprenait, je pensais qu’il aurait pu me remettre les objets de l’avant-dernière existence passée, l’ancien me regardait et me donnait une charrette pour jouer avec ; jeu de joies innocentes de mon enfance.
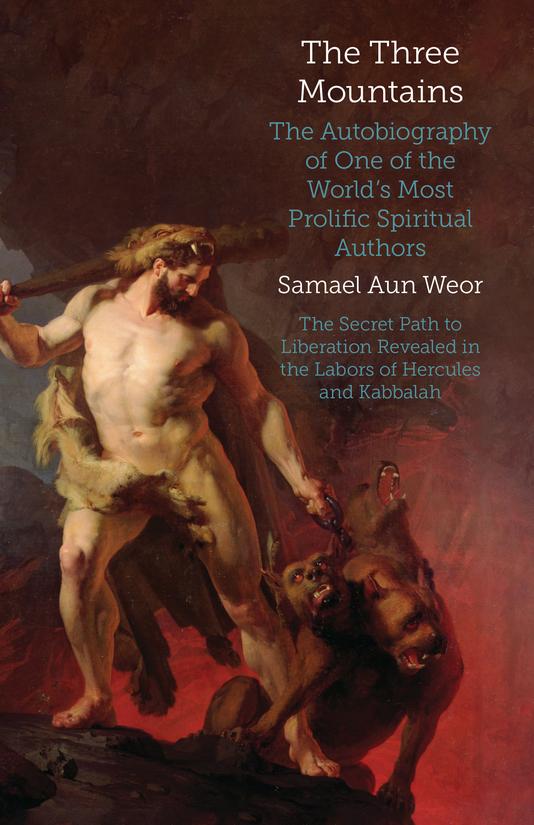
Ce chapitre est tiré de Les Trois Montagnes (1972) par Samael Aun Weor.