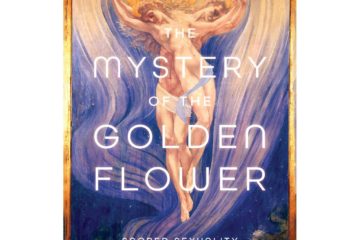Écrit par : Samael Aun Weor Catégorie : Le Mystère de la Fleur d’Or
C’est par une série de récits insolites que je veux expliquer maintenant ce qu’est la Loi de Récurrence.
Assurément, cette loi n’a jamais été pour moi quelque chose de nouveau, d’étrange ou d’extravagant : au nom de Cela qui est le Divin, je dois affirmer avec énergie que cette règle pragmatique, je ne l’ai connue qu’à travers les évènements inusités de mon vécu.
Rendre compte de tout ce que, réellement, nous avons expérimenté directement, est un devoir envers nos semblables.
Jamais je n’ai voulu m’échapper, m’esquiver intellectuellement de cette multiple variété de souvenirs en relation avec mes trois dernières existences antérieures et avec ce qui correspond à ma vie actuelle.
Pour le bien de la grande cause pour laquelle nous luttons intensément, je préfère payer mon dû, assumer mes responsabilités, confesser franchement mes erreurs en m’en remettant au verdict solennel de la conscience publique.
En toute franchise et sans ambages, il est opportun de déclarer ici même que j’ai été, en Espagne, le marquis Juan Conrado, troisième grand Seigneur de la province de Grenade.
C’était, incontestablement, l’époque dorée du fameux Empire d’Espagne : le cruel conquistador Hernan Cortes, une personne perfide, avait transpercé de son épée le cœur du Mexique tandis que l’impitoyable Pizarro, au Pérou, faisait fuir les cent mille vierges.
Tout comme beaucoup de nobles et de plébéiens, d’aventuriers et de pervers qui, en quête de fortune, s’embarquaient constamment pour la Nouvelle Espagne, je ne pouvais d’aucune manière être une exception.
Dans une simple caravelle, fragile et légère, je naviguais durant plusieurs mois sur l’océan orageux dans le but de parvenir à ces terres d’Amérique.
Il n’est pas superflu de certifier que jamais je n’ai eu l’intention de saccager les temples sacrés des augustes Mystères, ni de conquérir des peuples ou de détruire des citadelles.
Si j’ai parcouru ces terres d’Amérique, c’est, je l’affirme, en quête de fortune ; malheureusement, j’ai commis quelques erreurs.
Il est nécessaire de les étudier pour connaître les parallèles et constater concrètement comment fonctionne la sage Loi de la Récurrence.
C’était mon temps de « Bodhisattva tombé », et je n’étais certes pas une douce brebis.
Les siècles ont passé, et comme j’ai la conscience éveillée, il est évident que jamais je n’ai pu oublier toutes ces sottises.
Le premier parallèle que nous devons étudier correspond exactement à mon corps physique actuel.
Après être arrivé de la mère patrie dans une frêle embarcation, je m’établis tout près des falaises, sur les côtes de l’Atlantique.
En ces jours de la conquête espagnole, il y avait, malheureusement, ce trafic international relatif à l’infâme vente des noirs africains.
Alors, pour le bien ou pour le mal, j’ai connu une noble famille de couleur, originaire d’Algérie.
Je me souviens encore d’une petite demoiselle très noire, et aussi belle qu’un rêve miraculeux des Mille et Une Nuits.
Si j’ai partagé avec elle le lit des plaisirs dans le jardin des délices, c’est que j’étais, réellement, mû par l’aiguillon de la curiosité ; je voulais connaître le résultat de ce croisement racial.
Que de ce croisement soit né un rejeton mulâtre, il n’y a là rien d’extraordinaire ; puis vint le petit-fils, l’arrière-petit-fils et l’arrière arrière-petit-fils.
En ces temps de Bodhisattva tombé, j’avais oublié les fameuses marques astrales qui ont leur origine dans le coït et que tout désincarné porte dans son Karmasaya.
Il s’avère clair et manifeste que ces marques nous mettent en relation avec les gens et le sang associés par le coït chimique ; soulignons, en passant, que les Yogis de l’Inde ont déjà consacré à ce sujet des études minutieuses.
Il n’est pas inutile de déclarer que mon corps physique actuel provient de ladite copulation métaphysique ; en d’autres mots, je dirai que c’est ainsi que j’en suis venu à être revêtu de la chair que je porte dans mon existence présente. Mes ancêtres paternels furent précisément les descendants de cet acte sexuel du Marquis.
C’est une chose étonnante que nos descendants, à travers le temps et la distance, deviennent nos ascendants. Il est merveilleux qu’après quelques siècles, nous venions nous revêtir à nouveau de notre propre chair, nous convertir en fils de nos propres fils.
Des voyages incessants à travers ces terres de la Nouvelle Espagne caractérisèrent la vie du Marquis, voyages qui furent répétés dans mes existences subséquentes, l’actuelle incluse.
Litelantes, comme toujours, était à mes côtés, supportant patiemment toutes ces bêtises de mon temps de Bodhisattva tombé. En arrivant à l’automne de la vie, dans chacune de mes réincarnations, je confesse sans ambages que toujours j’ai fini par aboutir avec la « Fossoyeuse », je veux parler d’une antique initiée pour laquelle j’abandonnais toujours mon épouse et qui, d’une existence à l’autre, accomplissait son devoir de me donner une sépulture chrétienne.
Au déclin de ma vie présente, elle revint vers moi, cette antique initiée ; je la reconnus immédiatement, mais étant donné qu’à présent je ne suis plus tombé, je l’ai répudiée avec douceur ; elle s’est éloignée, affligée.
Revêtu de cette personnalité hautaine, voire même insolente, du Marquis, j’ai entrepris le retour à la mère patrie, après une certaine querelle dégoûtante motivée par un chargement de diamants bruts extraits d’une mine fort riche.
Pour le bien de nombreux lecteurs, il n’est pas superflu de mettre une certaine insistance pour affirmer crûment qu’après un court intervalle dans la région des morts, j’ai dû entrer à nouveau en scène en me réincarnant en Angleterre.
Je suis entré dans l’illustre famille Bleler et on me baptisa du pieux prénom de Siméon.
Dans la fleur de ma jeunesse, je suis passé en Espagne, mû par l’intense désir intime de retourner en Amérique. C’est ainsi que travaille la Loi de la Récurrence.
Indubitablement, les mêmes scènes se sont répétées, dans l’espace et dans le temps, des drames identiques, des adieux similaires, etc., y compris, comme il se doit, le voyage à travers l’océan tumultueux.
Intrépide, je sautais à terre sur les côtes tropicales de l’Amérique du Sud, habitées alors par différentes tribus.
En explorant de vastes régions couvertes de forêts qui regorgeaient de bêtes féroces, j’atteignis la vallée profonde la Nouvelle Grenade, au pied des montagnes de Montserrat et Guadeloupe : beau pays gouverné par le vice-roi Solis.
Il est indéniable qu’en ce temps-là en fait, je commençais à payer le Karma que je devais depuis les années du Marquis.
Parmi ces créoles de la Nouvelle Espagne, mes efforts pour obtenir un travail bien rémunéré se révélaient inutiles ; désespéré par ma mauvaise situation économique, je m’enrôlais comme simple soldat dans l’armée du Souverain : là, au moins, je trouvais pain, vêtement et refuge.
Un jour de fête, il arriva que de très bon matin, les troupes de sa Majesté s’apprêtaient à rendre des honneurs très spéciaux à leur chef, et pour cela se distribuaient ici et là, effectuant des manœuvres dans le but d’organiser des files.
Je me souviens encore d’un certain sergent antipathique et querelleur qui, passant en revue son bataillon, lançait des cris, maudissait, frappait, etc.
Tout à coup, s’arrêtant devant moi, il m’insulta gravement parce que mes pieds n’étaient pas dans la position militaire correcte, puis, examinant minutieusement mon veston, il me souffleta perfidement.
Ce qui arriva par la suite n’est pas bien difficile à deviner : on ne peut jamais rien attendre de bon d’un Bodhisattva tombé. Sans aucune réflexion, stupidement, j’enfonçais ma baïonnette acérée et sanguinaire dans sa poitrine aguerrie.
L’homme tomba à terre, blessé mortellement ; on entendait partout des cris de frayeur, mais je fus astucieux et, profitant précisément de la confusion, du désordre et de l’épouvante, je m’échappais de cet endroit, poursuivi de très près par la soldatesque bien armée.
J’empruntais plusieurs chemins en direction des côtes escarpées de l’océan Atlantique ; je me cachais n’importe où, et j’évitais toujours de passer par les barrages douaniers en faisant de grands détours à travers la forêt.
Dans les chemins carrossables, qui étaient très rares en ce temps-là, passaient à côté de moi des voitures tirées par une paire de vigoureux coursiers : dans ces véhicules voyageaient des gens qui n’avaient pas mon Karma, des personnes riches.
Un jour, au bord du chemin, près d’un village, je trouvais une humble auberge et y pénétrais, dans l’esprit de boire un verre, histoire de me redonner un peu de courage.
Stupéfait, interdit, ébahi, je découvris que la patronne de ce commerce était Litelantes ! Oh ! Je l’avais tellement aimée et maintenant je la retrouvais mariée et mère de plusieurs enfants. Quelle réclamation pouvais-je faire ? Je payais la note et je sortis, le cœur déchiré.
Je continuais à marcher sur le sentier lorsqu’avec une certaine crainte, je pus constater que quelqu’un venait derrière moi : le fils de la dame, une espèce d’alcade, de maire rural. Le jeune homme prit la parole pour me dire : « Selon l’article 16 du Code du vice-roi, vous êtes en état d’arrestation. » J’essayais, inutilement, de le suborner : le jeune homme, bien armé, me conduisit devant les tribunaux et il est évident qu’après avoir été condamné, je dus payer, par un très long emprisonnement, la mort du Sergent.
Lorsqu’on me remit en liberté, je longeais les rives sauvages et terribles du puissant fleuve Magdalena, exerçant de très durs travaux matériels partout où j’en avais l’occasion.
En guise de parenthèse intéressante dans ce chapitre, je dois dire que l’Essence de cet alcade à cause duquel j’ai dû supporter tant d’amertumes, enfermé dans une immonde basse-fosse, est retournée avec un corps féminin ; elle est maintenant ma fille ; en passant, elle est même, aujourd’hui, mère de famille et m’a donné quelques petits-enfants.
Avant sa réincorporation, j’ai interrogé cette âme dans les mondes suprasensibles ; je lui ai demandé la raison qui la poussait à me vouloir pour père ; elle me répondit en disant qu’elle avait du remords pour le mal qu’elle m’avait causé et qu’elle voulait se distinguer par une bonne conduite avec moi, afin d’amender ses erreurs. J’avoue qu’elle est en train de remplir son engagement.
À cette époque, je me suis établi sur les côtes de l’océan Atlantique, après d’infinies amertumes karmiques, revenant ainsi sur tous les pas de l’insolent marquis Juan Conrado. Le mieux que j’aie fait fut d’avoir étudié l’ésotérisme, la médecine naturelle, la botanique.
Les nobles aborigènes de ces terres tropicales m’offrirent leur amour reconnaissant pour mon labeur de Galien : je les guérissais toujours de façon désintéressée.
Une chose insolite se produisit un jour : il s’agit de la spectaculaire apparition d’un grand seigneur venu d’Espagne. Ce gentilhomme me raconta ses infortunes. Il apportait dans son navire toute sa fortune et les pirates le poursuivaient. Il voulait un endroit sûr pour ses abondantes richesses.
Fraternellement, je lui apportais la consolation et lui proposais même de creuser une grotte pour y garder ses richesses : le sieur accepta mes conseils, non sans exiger de moi auparavant un solennel serment d’honnêteté et de loyauté.
Avec la fraîcheur de la sincérité et le parfum de la courtoisie, nous nous sommes tous les deux mis d’accord. Ensuite j’ai donné des ordres à mes gens, un groupe très choisi d’aborigènes : ces derniers entrouvrirent l’écorce de la terre.
Une fois le trou fait, nous y déposâmes, avec une grande diligence, une grande malle et un coffre plus petit contenant des pépites d’or massif et de précieux joyaux d’une valeur incalculable.
Au moyen de certains exorcismes magiques, j’obtins l’enchantement du « trésor bien gardé », comme dirait Don Mario Roso de Luna, dans le but de le rendre invisible aux désagréables yeux de la convoitise.
Le gentilhomme m’a très bien rémunéré en me remettant généreusement une bourse de pièces d’or, puis il s’éloigna de ces lieux avec l’intention de revenir à sa mère patrie pour en ramener sa famille, car il désirait s’établir de manière seigneuriale sur ces belles terres de la Nouvelle Espagne.
Le sablier du destin n’est jamais en repos ; passèrent les jours, les mois et les années, et l’honnête homme ne revint jamais ; peut-être est-il mort sur sa terre ou tombé victime de la piraterie qui alors infestait les sept mers, je ne sais.
Il y a des concours de circonstances sensationnels dans la vie ; un jour, dans ma présente incarnation, me trouvant loin de ma terre mexicaine, je conversais sur ce sujet avec un groupe de frères gnostiques parmi lesquels se distinguait par sa sagesse le Maître Gargha Kuichines. C’est alors que j’eus une formidable surprise : je vis avec un étonnement mystique le Souverain Commandeur GK se lever pour confirmer de façon péremptoire mes paroles.
Ce Maître nous informa qu’il avait vu personnellement ce récit, écrit en vers sublimes. Il nous parla d’un vieux livre poussiéreux et regrettait de l’avoir prêté. Que Dieu et Sainte-Marie me gardent ! Si jamais je connaissais l’existence de ce traité.
Certaines traditions très anciennes nous disent que beaucoup de gens de ces côtes des Caraïbes ont cherché le trésor de Bleler.
Le plus curieux, c’est que ces nobles aborigènes qui jadis avaient enterré une aussi grande fortune s’étaient de nouveau réincorporés en formant le groupe du Summum Supremum Sanctuarium. C’est ainsi que travaille la Loi de Récurrence.
Je me souviens clairement qu’après cette existence tumultueuse sous la personnalité anglaise en question, je fus constamment invoqué par ces personnes qui se consacraient au spiritisme ou au spiritualisme. Ils voulaient que je leur dise l’endroit où se trouvait conservé l’or délicieux ; ils convoitaient le trésor de Bleler ; cependant, il est évident que, fidèle à mon serment dans la région des morts, je n’ai jamais voulu leur livrer le secret.
Revenant sur les traces de l’insolent marquis Juan Conrado, dans mon existence subséquente, je vins me réincarner au Mexique ; on me baptisa du nom de Daniel Coronado ; je naquis au nord, dans les environs d’Hermosillo, tous ces endroits ayant été connus à une autre époque par le Marquis. Mes parents voulaient pour moi tout le bien possible et, tout jeune encore, ils m’inscrivirent à l’Académie militaire, mais ce fut en vain.
Un jour parmi tant d’autres, j’ai mal employé une fin de semaine à festoyer et à m’enivrer avec des amis écervelés. J’avoue encore avec une certaine honte que j’ai dû revenir à la maison avec l’uniforme de cadet sale, déchiré et avili. Il va sans dire que mes parents furent très déçus.
Il est ostensible que je ne suis jamais retourné à l’Académie militaire ; c’est, indubitablement, à partir de ce moment qu’a commencé mon chemin d’amertumes.
Heureusement, j’ai alors rencontré de nouveau Litelantes ; elle se trouvait réincarnée sous le nom de Ligia Paca (ou Francisca) : cette fois, enfin, elle m’eut pour époux.
Faire la biographie de quelque vie que ce soit s’avère, en fait, un travail très difficile, car la matière est très riche, et c’est pourquoi je me contente de faire ressortir certains détails, à des fins ésotériques.
Le moins que je puisse dire, c’est que je ne jouissais pas d’une situation aisée, je gagnais difficilement le pain de chaque jour ; souvent, je mangeais grâce au misérable salaire de Ligia ; elle était une pauvre maîtresse d’école rurale et, pour comble, je la tourmentais avec mon exécrable jalousie. Je ne voulais pas voir d’un bon œil tous ses collègues de l’enseignement qui lui offraient leur amitié.
Néanmoins, j’ai fait une chose utile à cette époque : j’ai formé un beau groupe ésotérique gnostique en plein District fédéral : les étudiants de cette congrégation, dans mon existence actuelle, en accord avec la Loi de la Récurrence, sont retournés vers moi.
Durant le sanglant régime de Porfirio Diaz, j’ai eu un emploi certes pas très agréable dans la police rurale. J’ai commis l’erreur impardonnable de traduire en justice le fameux « Golondrino », dangereux bandit qui dévastait la contrée ; ce malfaiteur mourut fusillé.
Dans mon existence actuelle, je l’ai rencontré à nouveau, réincorporé dans un corps humain féminin ; elle souffrait de délire de persécution, elle craignait qu’on l’incarcère pour vol ; elle luttait pour se défaire de liens imaginaires ; elle croyait alors qu’on allait la fusiller. Il est clair qu’en guérissant cette malade, j’ai annulé ma dette ; les psychiatres avaient lamentablement échoué : ils n’avaient pas été capables de la soigner.
Au moment où éclata la rébellion contre Don Porfirio Diaz, j’abandonnais le funeste poste dans la police rurale ; alors, avec d’humbles prolétaires au pic et à la pelle, de pauvres ouvriers tirés des fermes des patrons, j’organisais un bataillon. Elle était certainement admirable, cette valeureuse poignée d’humbles gens à peine armés de machettes, car personne n’avait assez d’argent pour acheter des armes à feu. Heureusement, le général Francisco Villa nous reçut dans la Division du Nord ; là, on nous donna des chevaux et des fusils.
Nul doute qu’en ces années de tyrannie, nous luttions pour une grande cause ; le peuple mexicain gémissait sous les bottes de la dictature.
Au nom de la vérité, je dois dire que ma personnalité en tant que Daniel Coronado fut, à coup sûr, un échec ; l’unique chose pour laquelle il valut la peine de vivre fut pour le groupe ésotérique dans le District fédéral, et pour mon sacrifice dans la Révolution.
Je dis à mes compagnons de la rébellion : j’ai abandonné les rangs lorsque je suis tombé gravement malade. Dans les derniers jours de cette vie tumultueuse, j’ai parcouru les rues du District fédéral, nu-pieds, les vêtements en lambeaux, affamé, vieux, malade et mendiant.
Avec un profond chagrin, je confesse franchement que j’ai fini par mourir dans une immonde baraque.
Je me souviens encore de cet instant où le médecin, assis sur une chaise, après m’avoir examiné, s’exclama en bougeant la tête : « C’est un cas perdu. »
Après quoi il se retira.
Ce qui suivit immédiatement est terrible : je sens un froid épouvantable comme un glaçon de mort. À mes oreilles parviennent des cris de désespoir : « Saint-Pierre, Saint-Paul, aidez le ! » Ainsi s’écrie cette femme que je nomme la « Fossoyeuse ».
D’étranges mains squelettiques me saisissent par la taille et me tirent du corps physique ; nul doute que c’est l’Ange de la Mort qui est intervenu : résolument, il coupe avec sa faux le cordon d’argent, puis il me bénit et s’éloigne.
Mort bénie, combien de temps cela faisait-il que je t’attendais, enfin tu arrivais à mon aide ; avait-elle été assez amère, mon existence !
Je reposais heureux dans les mondes supérieurs, après d’innombrables amertumes : il est certain que la souffrance humaine des mortels a aussi sa limite, au-delà de laquelle règne la paix.
Malheureusement, il ne dura pas longtemps, ce repos dans le sein profond de l’Éternité : un jour, tout doucement, l’un des brillants Seigneurs de la Loi vint vers moi. Il prit la parole et dit : « Maître Samaël Aun Weor, tout est prêt, suivez-moi. »
J’ai répondu aussitôt : « Oui, vénérable Maître, c’est bien, je vous suis. » Nous avons alors passé ensemble par divers endroits et avons finalement pénétré dans une maison seigneuriale ; nous avons traversé une cour, puis une salle, et ensuite nous sommes entrés dans la chambre de la parturiente : nous l’avons entendu se plaindre et souffrir des douleurs de l’enfantement.
C’est à cet instant mystique que j’ai vu avec étonnement le cordon d’argent de mon existence actuelle connecté psychiquement à l’enfant qui était sur le point de naître.
Quelques instants plus tard, cette créature inspirait avec avidité le Prana de la vie : je me suis senti attiré vers l’intérieur de ce petit organisme, puis j’ai pleuré de toutes les forces de mon âme.
J’aperçus autour de moi quelques personnes qui souriaient, et j’avoue que mon attention fut tout particulièrement sollicitée par un géant qui me regardait avec affection ; c’était mon progéniteur terrestre.
Il n’est pas superflu de dire, avec une certaine insistance, que ce bon auteur de mes jours fut, à l’époque médiévale, au temps de la chevalerie, un noble seigneur que j’eus à vaincre dans de sanglantes batailles. Il jura alors de se venger et il est clair qu’il a rempli sa promesse par mon existence présente.
J’ai abandonné la maison paternelle très jeune, mû par de douloureuses circonstances, et j’ai voyagé par tous ces endroits où j’étais allé auparavant, au cours de mes existences passées.
Les mêmes drames se sont répétés, les mêmes scènes : Litelantes est apparue à nouveau sur mon chemin ; j’ai retrouvé mes vieux amis, j’ai voulu leur parler, mais ils ne m’ont pas reconnu, mes efforts furent inutiles pour leur faire se rappeler nos jours révolus.
Néanmoins, quelque chose de nouveau s’est produit dans ma présente réincarnation : mon Être Réel intérieur fit des efforts désespérés, terribles, pour me ramener sur le droit chemin duquel je m’étais détourné depuis longtemps.
Je confesse franchement que j’ai dissous l’Ego et que je me suis levé de la boue de la terre.
Il est évident que le Moi est soumis à la Loi de récurrence, lorsque le « Moi-même » est dissous, nous acquérons la liberté, nous nous affranchissons de ladite loi.
La pratique m’a enseigné que les différentes scènes des diverses existences se déroulent à l’intérieur de la spirale cosmique, en se répétant toujours sur des spires soit plus hautes, soit plus basses.
Tous les faits et gestes du Marquis, y compris ses innombrables voyages, se répétèrent toujours, sur des spires chaque fois plus basses, dans les trois réincarnations subséquentes.
Il existe, dans le monde, des personnes effectuant une répétition automatique exacte ; des gens qui renaissent toujours dans le même peuple et dans la même famille.
Il est évident que les Egos de ces gens connaissent alors leur rôle par cœur et vont même jusqu’à s’offrir le luxe de prophétiser sur eux-mêmes ; ainsi donc, la constante répétition leur permet de se souvenir des évènements, c’est pour cette raison qu’ils semblent être des devins.
Ces personnes étonnent souvent leurs proches par l’exactitude de leurs pronostics.
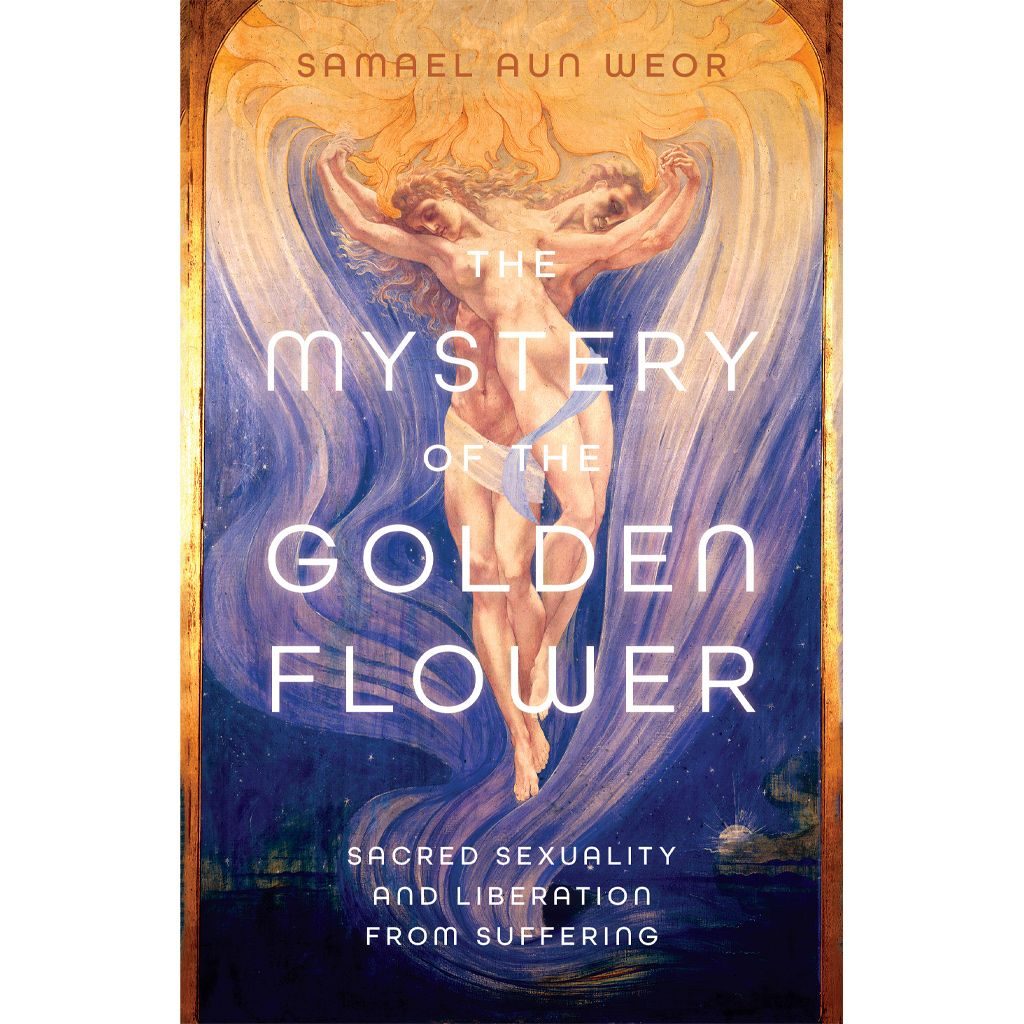
Ce chapitre est tiré de Le Mystère de la Fleur d’Or (1971) de Samael Aun Weor.